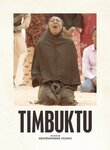
France/Mauritanie 2014 (sortie prévue le 10 décembre) 1h37 vostf
Avec : Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri, Fatoumata Diawara, Hitchem Yacoubi…
Prix du Jury œcuménique et Prix François Chalais Cannes 2014
« Timbuktu » reflète l’actualité brûlante du nord de l’Afrique, et du Mali en particulier, puisque le film se passe dans le contexte de l’avancée djihadiste jusqu’aux portes de Tombouctou. Mais c’est avant tout du très beau cinéma que déploie le réalisateur, mêlant actu et récit tragique, à coups de plans amples, de tempo fluide et de la photo majestueuse de Sofian El Fani, chef op’ de Kechiche. Les djihadistes font régner la terreur et la charia à coups d’interdits tous plus absurdes les uns que les autres, alors qu’une tragédie couve à feu doux comme un western, opposant un berger à un pêcheur.
Sissako incarne un contexte dont on parle tous les jours dans les médias mais qui n’est jamais montré comme dans ce film : beauté de la topographie et des visages, quotidien d’un village africain avec ses maisons en torchis, ses ruelles de sable, ses ânes et mobylettes, ses jerrycans qui remplacent l’eau courante. Surtout, Sissako ne verse dans aucune caricature. Bien que prenant parti pour les populations opprimées, il prend soin de filmer les intégristes avec des plans égaux et en les laissant développer leur casuistique. Les fondamentalistes ne sont pas tout d’un bloc : l’un est allumé, l’autre pas vraiment convaincu, un troisième fume en loucedé et pourrait presque paraître sympa… Sissako ne filme pas des monstres mais une idéologie monstrueuse. Et il décortique la folie intégriste qui prétend imposer une pratique déviante de l’islam à des gens qui sont déjà de pieux musulmans.
Une antonionienne partie de foot sans ballon rappelle que partout dans le monde, on peut tout interdire, sauf ce que les êtres pensent et ressentent intérieurement. Beau film, politique et seigneurial."
Serge Kaganski "Les Inrocks" mai 2014
« Le vrai courage, c’est ceux qui ont vécu un combat silencieux. Tombouctou n’a pas été libéré par Serval. La vraie libération, c’est ceux qui chantaient au quotidien dans leur tête une musique qu’on leur avait interdite, ceux qui jouaient au foot sans ballon »
Abderrahmane Sissako Conférence de presse Cannes mai 2014

Quelques critiques
"On pourra voir tous les matchs de la coupe du monde, cela n’atteindra pas la puissance que dégage la partie de foot sans ballon que filme Abderrahmane Sissako alors que le ballon rond a été confisqué aux gamins par ordre coranique. Scène magique où les enfants se passent du bout du pied un ballon imaginaire qui finira joyeusement au fond des filets. C’est avec une belle intelligence que le cinéaste mauritanien met en scène l’absurdité brutale de djihadistes en contraste avec un Islam modéré. Et dans les intégristes, il y a ceux qui n’ont aucun état d’âme mais aussi des jeunes recrues venues de France notamment, et que l’on sent endoctrinées et fragiles. Entre violence et poésie, pas de clichés, pas de pathos, juste une larme qui coule sur la joue d’un père qui comprend qu’il ne pourra plus protéger son enfant. Tout en filmant des fous de Dieu qui interdisent, fouettent, prennent en otage, lapident, il baigne son film d’une BO ample et lyrique comme s’il refusait l’interdit. Le film de Sissako se met en résistance avec dignité, rejetant l’affront intégriste avec subtilité, à l’image de cette femme que des djihadistes obligent à porter des gants alors qu’elle vend du poisson. Fatiguée de leurs sentences absurdes, elle offre ses mains à couper car sans main, pas de gant.
Sissako montre l’impensable dans des décors de sable grandioses. Cette poésie accentue le sentiment de brutalité. Au début du film, on voit une jeune gazelle courir affolée dans les dunes car elle est poursuivie par des hommes armés de kalachnikovs. « Ne la tuez pas, épuisez-la », lance un type armé à ses copains tout aussi armés que lui. À la fin du film, c’est une fillette qui court à perdre haleine comme une bête traquée. Entre ces deux scènes, Sissako exprime avec une étonnante douceur les plaies béantes du Nord du Mali, vidé de son humanité par un extrémisme effrayant. Timbuktu s’impose dès lors comme nécessaire."
Fabienne Bradfer Le Soir 15/05/14

"Ça commence avec une gazelle au galop, prise en chasse par des djihadistes avec un pick-up. Et cela finit mal à cause d’une vache qui s’est pris les pieds dans un filet de pêche. Chez Abderrahmane Sissako tout part d’un rythme naturel : les pas d’un homme dans le sable, la vie d’une famille dans les dunes, le jeune garçon courant après un troupeau de bétail, la jeune fille qui trait les chèvres, la pirogue qui traverse la rivière…Avec sa caméra, Sissako ouvre l’espace. Il scrute les formes et les couleurs éternelles de ce pays, les maisons ocre, les visages balayés depuis toujours par le sable et le vent. Son cadre est comme une fenêtre basse près du sol à travers laquelle on regarde son histoire. Il montre le fleuve, le désert, les rues de Tombouctou comme des univers reliés à notre monde par des voies mystérieuses. Il nous impose des images qui entrainent la lenteur, la profondeur… et la réflexion.
Tourné dans le plus grand secret près de la frontière malienne, dans une zone rouge dans l’extrême est de la Mauritanie, Timbuktu nous raconte deux histoires entrecroisées : celle bien connue et redoutée des djihadistes venus d’ailleurs qui occupent la ville de Tombouctou en 2012. Des extrémistes religieux qui tirent sur des sculptures et assassinent une culture millénaire. Ils ne parlent pas la langue des habitants, mais infligent avec leurs kalachnikovs à la population leur cruelle interprétation de la loi islamiste : obligation pour les femmes de se voiler, 40 coups de fouet pour avoir chanté ou joué au foot, des mariages forcés et la lapidation des amoureux non mariés…L’autre histoire nous fait vivre la vie de Kidane, un éleveur qui mène avec sa femme et sa fille une vie simple et heureuse au milieu des dunes. Cette existence paisible s’arrête brusquement quand celui-ci décide que l’humiliation ne peut plus durer. Il tue accidentellement Amadou le pêcheur pour venger la mort de sa vache préférée. Quelle justice possible après la mort d’un homme ?
Pour contrer l’obscurantisme, Abderrahmane Sissako ne met pas les gyrophares, mais allume les phares. En filigrane, il pose la question de la vache sacrée et des limites qu’on se pose et tolère comme individu et en tant que société. Il y a la vendeuse de poisons qui refuse de porter des gants, la comédie des jeunes qui vivent leur passion pour le foot sans le ballon, la chanteuse qui continue à chanter sous les coups de fouets, mais aussi le djihadiste qui se cache pour fumer ou danser. Timbuktu navigue entre le Bien et le Mal, entre les langues, les cultures, la ville et le désert, entre hommes et femmes, entre la justice et la charia, entre l’islam et le jihad, entre l’éternel et l’éphémère. Un récit tragique et complexe, rythmé par des silences et des images d’un calme absolu. N’empêche, à la fin, la société a bien volé en éclats."
Siegfried Forster RFI 15/05/14
Interview d’Abderrahmane Sissako par Elisabeth Lequeret RFI 16/05/14
– Dans Timbuktu vous montrez l’occupation de la ville sainte par les djihadistes. A la conférence de presse, on vous a vu très ému. Est-ce que vous avez le sentiment de porter la voix de ces populations aux yeux du monde ?
Je ne sais pas. Chaque fois qu’on se met à la place des autres ou que l’on prétend que l’on peut faire le bonheur des autres ou que l’on pense que l’on a une sorte de légitimité de faire cela, je pense qu’on se trompe un peu. Donc je n’ai pas ce sentiment. Mais ce film raconte la vie des gens qui étaient dans une forme d’anonymat, donc qui ont vécu et souffert énormément. Si le cinéma permet de parler d’eux et non pas de Serval [l’opération militaire de France au Mali, ndlr] – pour ne critiquer personne – mais du combat silencieux des hommes et des femmes qui chantent dans leur tête. La musique est en effet interdite. C’est ça qui m’intéresse dans le cinéma. L’actualité dans le nord du Mali interpelle depuis un certain temps beaucoup de gens : des écrivains, des chanteurs, des journalistes qui laissent parfois leur vie. Donc je fais partie de ceux qui se disent qu’on ne peut pas rester indifférent. J’essaie de diminuer le plus possible ce préjudice causé à l’islam depuis un certain temps. L’islam n’est pas ce qui est montré dans le monde occidental. Il s’agit de gens qui l’ont pris en otage. Moi, je m’élève contre ça. La foi de l’Islam, c’est d’abord la tolérance, le respect de l’autre.
– Vous avez écrit ce film en quelques semaines. Comment est née l’idée de Timbuktu ?
Il est né après une « gestation » comme toute naissance. Il est né d’une révolte. D’abord, il y a eu en juillet 2012, dans une forme d’indifférence, la lapidation jusqu’à la mort d’un couple à Aguelhok, une petite ville au nord du Mali. Une ville oubliée de tous. C’est ça le problème. Quand une histoire ne se passe pas dans des endroits choisis pour raconter l’actualité comme Damas ou Téhéran, on n’en parle pas assez. On parle trop souvent de futilités. Tout le monde se rue quand un énième appareil de téléphone sort et même les journaux d’actualité en parlent. C’était le cas quand cette lapidation a eu lieu. Cela m’avait choqué.
– Plusieurs personnages se croisent dans Timbuktu. Des jeunes gens qui veulent continuer à faire de la musique alors que c’est interdit. Une vendeuse de poisson qu’on oblige à porter de gants. Une petite fille dont les parents sont des bergers et qui vivent éloigné de tout dans le désert. Ces personnages, comment sont-ils nés ?
Il y a eu plusieurs étapes. La première était d’écrire vite pour obtenir un financement pour le film. La deuxième étape était que, entretemps, Tombouctou était libéré, parce que j’avais commencé le film avant la libération de Tombouctou. Je suis allé à Tombouctou pour être beaucoup plus proche de ce qui se passait, pour ne pas me contenter de mon imagination lointaine. Et à Tombouctou, j’ai rencontré des gens. J’ai été très souvent ému, bouleversé et parfois séduit par le courage de certaines personnes. C’est cela qui a enrichi et construit mes personnages, comme la vendeuse de poisson qui est un personnage réel. Elle a défié à Tombouctou les djihadistes en disant : « Non, je suis honnête. Vous ne pouvez pas m’imposer cela. Vous n’êtes pas plus croyant que moi. » Il y a aussi la chanteuse Fatoumata Diawara qui avait réuni des musiciens pendant l’occupation pour chanter une chanson de paix à Tombouctou. Ces combats ne sont pas visibles.
Abderrahmane Sissako
par Siegfried Forster RFI (extraits)
Ses films sont intimement liés à son existence. Une vie passée entre les pays, les cultures et les continents. Né en Mauritanie, il grandit au Mali avant de faire ses classes de cinéaste à Moscou, puis de s’installer à Paris pour finalement retourner « au pays » à Nouakchott…Aujourd’hui, il a vécu plus de temps en France qu’au Mali ou en Mauritanie, même s’il y est retourné très souvent. Le regard, les images et les émotions transmises par son cinéma sont toujours restés profondément imprégnés de l’ambiance de ses pays d’origine. De son temps, à l’école du cinéma à Moscou, à l’époque de l’Union soviétique, il a gardé un sens particulier de la réalisation et du cadrage, et de la France peut-être une manière de raisonner… Son œuvre cinématographique se finance sur le continent européen, mais se construit sur le continent noir. Pour son cinéma, il est prêt à donner et à révéler beaucoup de lui-même. Pour Bamako, présenté en 2006 hors compétition à Cannes, il est retourné pendant deux ans au Mali pour préparer le tournage. Ce film qui a réalisé au cinéma l’utopie de mener un procès contre la Banque mondiale accusée d’être coupable de la mort de millions d’Africains, se déroule dans la cour même de la famille paternelle où Abderrahmane Sissako avait grandi…
Chez Abderrahmane Sissako, l’audace formelle et la rigueur du cadre sont exigées par le propos. Le style de ses films repose sur un rythme calme, la confiance dans les images, une écriture cinématographique où les mots ont leur importance, mais où les silences et l’inconscience restent les armes absolues du réalisateur. L’esthétique du Mauritanien qui frôle souvent l’austérité ne parie pas sur le pouvoir du cinéma de transformer le monde, mais espère éveiller les consciences et rendre justice.

